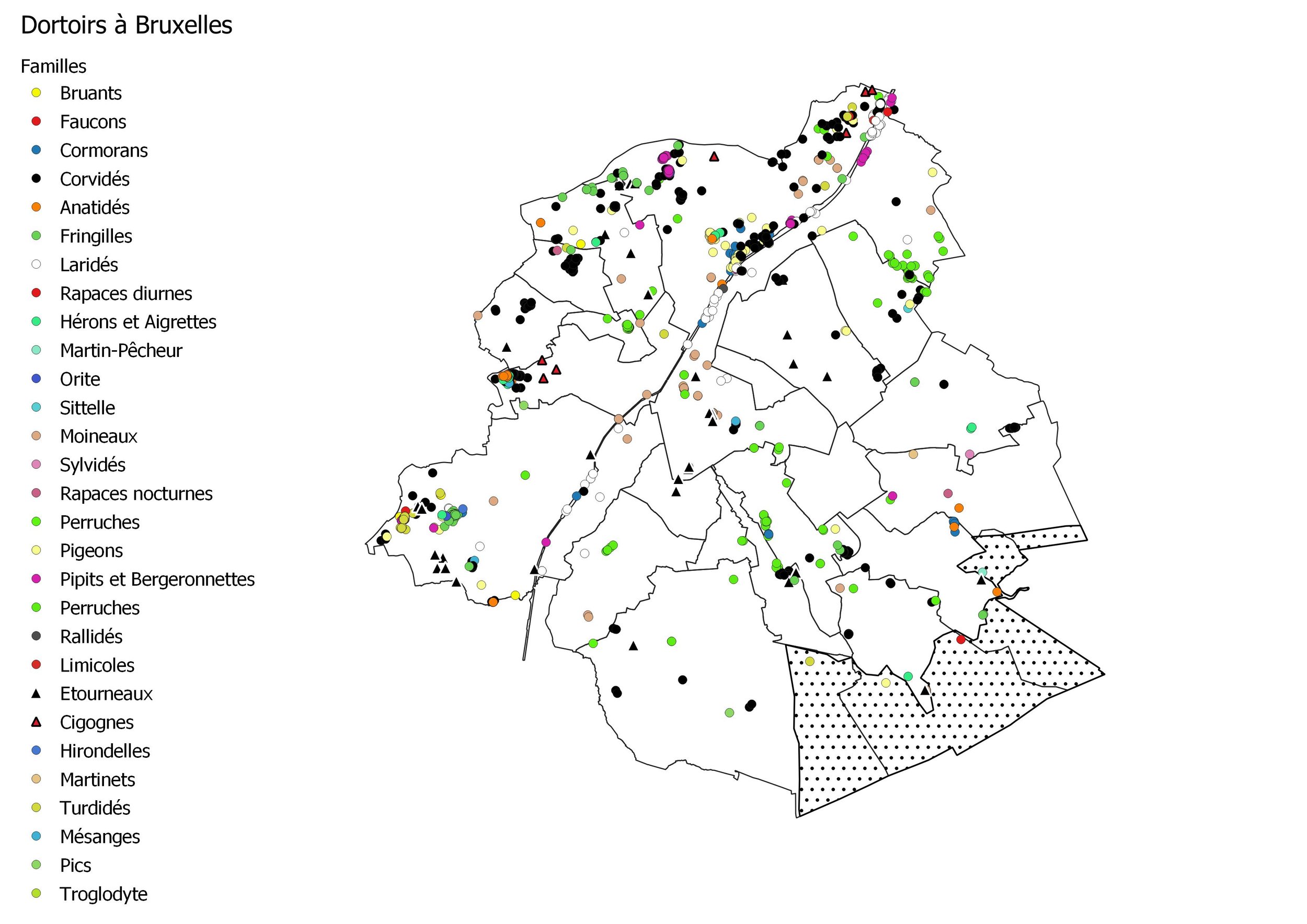La grippe aviaire est un terme qui désigne une maladie due à un ensemble de virus plus ou moins pathogènes selon la combinaison de leurs sous-types H et N. Certaines souches sont hautement pathogènes et causent la mort des oiseaux infectés, parfois en grands nombres. Certaines espèces sont plus sensibles que d’autres et toutes les souches du virus ne sont pas dangereuses. Le virus se transmet par les fientes, la salive et les contacts direct entre oiseaux. Il survit assez longtemps dans l’environnement, ce qui augmente la contamination. La transmission à l’homme est très rare mais possible, surtout chez des personnes en contacts étroit avec les oiseaux et leurs fientes. Le principal risque économique provient de l’abattage des volailles d’élevages possiblement contaminés et l’impossibilité d’exporter des volailles vers certains pays. Les virus voyagent sur de longues distances avec les oiseaux migrateurs mais aussi avec le commerce (légal ou non) d’oiseaux (surtout les volailles).
Depuis 2021, une souche hautement pathogène de la grippe aviaire (H5N1) est devenue endémique en Europe et dans le monde, des centaines de milliers d’oiseaux sauvages et domestiques ont été décimés par ce virus, particulièrement des oiseaux d’eau coloniaux (laridés, sternes, fous, pélicans…), des anatidés et des rapaces. Plusieurs cas ont été mentionnés et rapportés dans la presse en Wallonie (Clavier, Frasnes-lez-Anvaing…).
Cependant, en Flandre où les populations de sternes qui avaient été durement touchées par le virus, la situation s’est améliorée en 2024 avec une très bonne année de reproduction des Sternes caugek.
Groupe de Bernaches du Canada aux Barrages de l’Eau d’Heure, un site à risque car il abrite de nombreux oiseaux d’eau en hiver (photo Olivier Colinet).
La Belgique disposait déjà d’un système de veille permanente organisé depuis plusieurs année en collaboration avec l’IRSNB et Sciencano qui teste régulièrement les anatidés lors de séances de captures spécifiques. Suite à l’épidémie, le Service Public de Wallonie a rapidement mis en place un système d’alerte et des protocoles à suivre en cas de découverte de cadavres d’oiseaux suspects. Une page web et un portail d’encodage des données d’oiseaux morts ont été créés afin que les ornithologues, les autres acteurs de terrain et les particuliers puissent s’informer sur la maladie et renseigner des cas possibles.
Que faire en cas de découverte de cadavres d’oiseaux et de suspicion de grippe aviaire ?
Les ornithologues étant régulièrement sur le terrain et souvent proches des zones humides, là où les risques de contamination sont les plus élevés, ils sont en première ligne pour détecter les foyers potentiels de la maladie. Afin de limiter la propagation, il est de notre devoir de signaler au plus vite les cas suspects.
La première précaution à prendre est de ne pas toucher les cadavres, du moins sans gants de protection.
Vous pouvez contacter le service téléphonique SOS Environnement du SPW via le 1718 (1719 pour les germanophones) afin de signaler les cadavres. Une procédure interne au SPW sera alors mise en place pour évacuer les cadavres et tenter de limiter la propagation des éventuels virus.
Il est aussi possible d’encoder la découverte de cadavres via le portail de l’observatoire de la biodiversité. Una alerte sera alors donnée aux services compétents pour s’occuper de l’enlèvement des cadavres.
A Bruxelles, vous pouvez appeler le “Call Center Influenza” au numéro gratuit 0800 99 777.
En cas de découverte d’oiseaux malades, le mieux est de contacter un CREAVES.