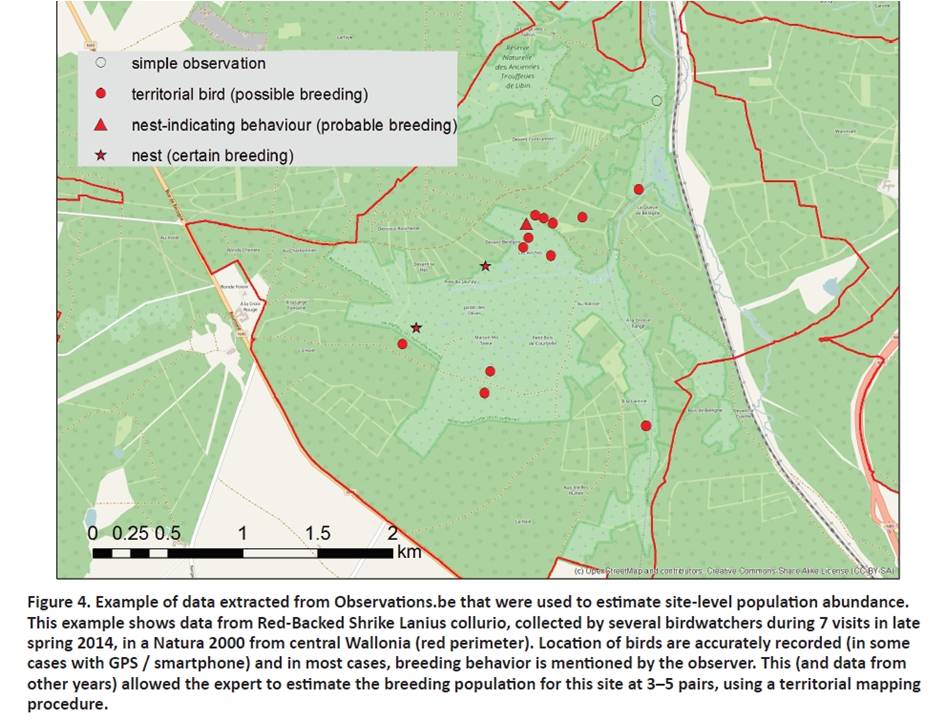Le réseau européen "Milan royal" recense les nicheurs mais aussi les hivernants
Depuis douze ans, en complément des nombreux inventaires de nicheurs, un recensement international est organisé en janvier à l’initiative de la LPO Mission Rapaces. Il vise à mieux cerner l’aire d’hivernage et la répartition des effectifs. Cette enquête est centrée sur la recherche et le dénombrement coordonné des dortoirs communautaires que forme ce rapace. Au moins 15 pays ont collaboré à cet inventaire les 6-7 janvier dernier. En Wallonie, l’ensemble des contacts avec des milans en janvier est par contre pris en compte, en raison de la faible présence hivernale.
En hiver, la Belgique se situe sur la frange nord-ouest de la répartition du Milan royal. Les suivis des derniers hivers ont montré que ce rapace est alors rare en Haute-Belgique et très rare plus au nord. Aucun dortoir de quelque importance n’a d’ailleurs été noté depuis des années. Ce fut encore le cas cet hiver.
L’hiver 2017-2018 en Wallonie
La migration postnuptiale s’est à nouveau prolongée en novembre et même en décembre. L’observation de quelques oiseaux apparemment en migration se répète alors le mois durant, à l’image des années précédentes : 3 ex. vers le sud-ouest à Fauvillers et 2 à Breuvanne le 1er, 1 ex. sur place le 2 à Bilstain, le 4 à Stembert, le 6 à Honnelle, le 24 à Elouges, le 26 à Buvrinne et le 28 à Houffalize.
En décembre, le nombre de contacts s’est réduit en cours de mois. Avec un total mensuel de 25 observations, il est néanmoins supérieur à celui de l’hiver-2016-2017 qui avait été particulièrement faible. Début 2018, à peine six observations d’isolés en première décade de janvier (lors du comptage) et 4 en deuxième décade. Aucun dortoir n’a été trouvé mais des hivernages locaux sont vraisemblables, en particulier dans la région de Remagne, en Ardenne luxembourgeoise. La répartition des observations de décembre-janvier (Fig. 1) est à nouveau centrée sur les régions herbagères de la Haute-Belgique, en particulier l’Ardenne.
Figure 1 : Carte des observations de décembre 2017 (bleu) et janvier 2018 (rouge) en Wallonie.
Figure 2 : Nombre d’observations en janvier en Wallonie de 2013 à 2018
L’amorce de retours est une nouvelle fois précoce. Dès la mi-janvier, certaines mentions peuvent concerner des migrateurs. Cela devient net en fin de mois et jusqu’au 5 février (13 observations). En particulier, le 1er février voit le retour (après une dernière nuit au Grand-duché de Luxembourg) de la femelle adulte « Wallerode » porteuse d’une balise gps. Partie le 1er janvier de sa zone d’hivernage en Extrémadure (Espagne), elle a mis un mois pour effectuer sa migration. Dans le même temps, tous les autres porteurs de balises sauf un, sont restés dans leur quartier d’hiver (J.-Y. Paquet, com. or.).
Et dans les régions voisines ?
A nouveau, peu de milans hivernent aux alentours de la Wallonie. Ainsi, une dizaine d’isolés en janvier en Flandre et aucun dans la Région Bruxelles-Capitale (source observations.be). Un seul début janvier au Grand-duché de Luxembourg où des retours apparents sont, par contre, enregistrés en fin de mois. Egalement très peu de mentions avant la fin du mois en Sarre, dans les lander de Rhénanie-Westphalie et Rhénanie-Palatinat (source www.ornitho.de ). En France, une donnée dans les Hauts-de-France (Département du Nord le 24 décembre 2017 - www.nordpasdecalais.observation.org) et un petit hivernage classique dans la Région du Grand–Est (Champagne-Ardenne et Alsace-Lorraine). Ici, 82 Milans royaux (87 en janvier 2017) ont été trouvés en dortoirs en janvier : 20 en Alsace, 12 en Lorraine et 52 en Champagne-Ardenne (Leblanc et al., 2018). Parmi les données provenant du département des Ardennes, la présence a à nouveau été notée à la décharge d’Eteignières (près de Rièzes).
Référence citée : G. Leblanc, S. Didier & A. Mionnet (2018) : Synthèse du comptage simultané en période hivernale des Milans royaux dans la Région Grand-Est (06 et 07 janvier 2017). Rapport LPO & LOANA, 4 pages.